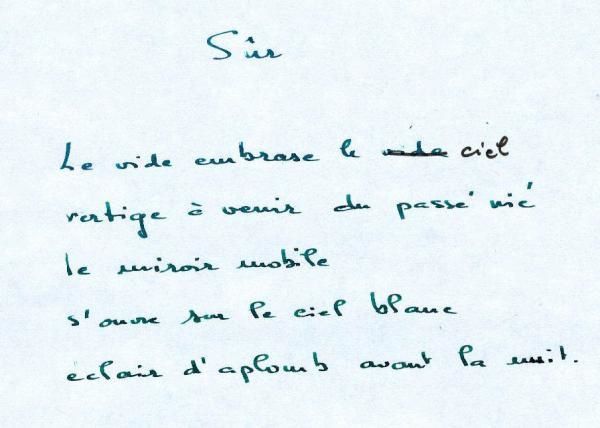
Récemment, je classais des papiers de banque, de caisse d'assurance maladie, de complémentaire retraite, de devis divers, à la recherche de l'immatriculation maritime du petit bateau d'occasion acheté l'an dernier. En fait ça ne m'arrive que très rarement de classer des papiers, vu l'intérêt de la chose.
Je vis entre les feuillets épars quelques pages blanches, avec au milieu, quelques phrases écrites à la main: l'écriture se voulait lisible, claire; une feuille semblait même écrite avec une plume calligraphique, à l'encre verte, tellement les pleins et les déliés étaient marqués.
Des poèmes! Et manifestement, l'écriture est de moi. Au total onze feuillets. en fait plus, parce que le dernier regroupe plusieurs feuilles marquées en haut à gauche "état 1", "état 2", etc jusqu'à 4, comme une gravure avec laquelle on fait des essais. Plus remarquable: tous les feuillets, sauf un, sont datés: le premier du 3 avril 2004, le second du 7 avril, puis les autres n'ont que la mention, ajoutée avec un autre stylo, avril 2004. La feuille non datée semble être une amorce de poème, quelques mots, (prendre/ au matin/ la main du jour), la suite étant biffée.
Vous me demandez que je vous livre ces poèmes? Peut être satisferais-je votre curiosité légitime! Le blog autorise une impudeur que je n'oserais autrement...
En tout cas, c'est sûr, en avril 2004 je fus "poète"! D'ailleurs Sûr est le premier poème, celui du 3 avril. un mot a été modifié plus tard. Allez ! je vous le livre:
Sûr
Le vide embrase le jour
vertige à venir du passé nié
le miroir mobile s'ouvre sur le ciel blanc
éclair d'aplomb avant la nuit.
J'en essaie l'exégèse en vain. Aucune idée de ce que j'ai voulu dire ! Je vous en laisse le soin. (mais il s'agit bien d'embraser et non d'embrasser). Le second est dédié à Alain, un graveur avec qui d'ailleurs j'ai fait deux petits livres (voir dans le blog Les territoires d'Alain Cazalis), mais c'étaient des textes d'amusement, des devinettes. Il doit correspondre à une gravure: je vous l'épargne donc.
Le troisième n'a pas d'indication de jour, mais comme il est écrit avec la même encre verte, je suppose qu'il a été écrit en même temps. A la relecture, je le trouve si fade que je ne vous le propose pas. Comme je ne peux pas tous les éliminer, n'est-ce pas?, je vous accorde le quatrième; il est sans titre.
La ligne qui se dessine là
bouge à peine sous le souffle
s'échappe en couleuvre
se tend en fouet du ciel
s'enroule en pelote prometteuse
se fixe en hypnotique lacet
s'égare en sillon ivre
s'écoule en ruisseau fier
se détend en liane nonchalante
s'aiguise en crête aride
la ligne qui se dessine ici
sera-t-elle horizon ou collet?
Mais parmi les feuillets un titre m'intrigue: Alzheimer
aux franges des cavernes dévastées
dans la nuit creusée de doute
les souvenirs égarés,
jalons dérisoires éparpillés
en mikado pathétique
Pourquoi ai-je écrit un poème sur la maladie d'Alzheimer, alors qu'aucun de mes proches n'en est atteint? Je ne me souviens pas, ce qui m'alarme tout à coup !
Un autre me semble un peu trop pessimiste:
Le champ est clos de brume
la bêche creuse la terre dure
la retourne, noire et pauvre
l'homme, seul dans le champ
(le champ n'est pas si grand)
progresse lentement.
Le soir noirçit la brume
la nuit ferme le champ
et l'homme dedans
rien ne dit que demain
lui permette de terminer
de bêcher le champ.
Enfin (je vois que je vous lasse), je treminerais par un plus léger, pour finir:
Point à la ligne
un point
une ligne courbe
inflexible
à
l'aplomb
certain
mais le point
malin
rend amoureuse
rend malheureuse
la ligne
brisée.
Eh oui! voilà comment, en avril 2004, quelqus jours seulement, mais plus après, je fus poète!
Il vous salue bien.











